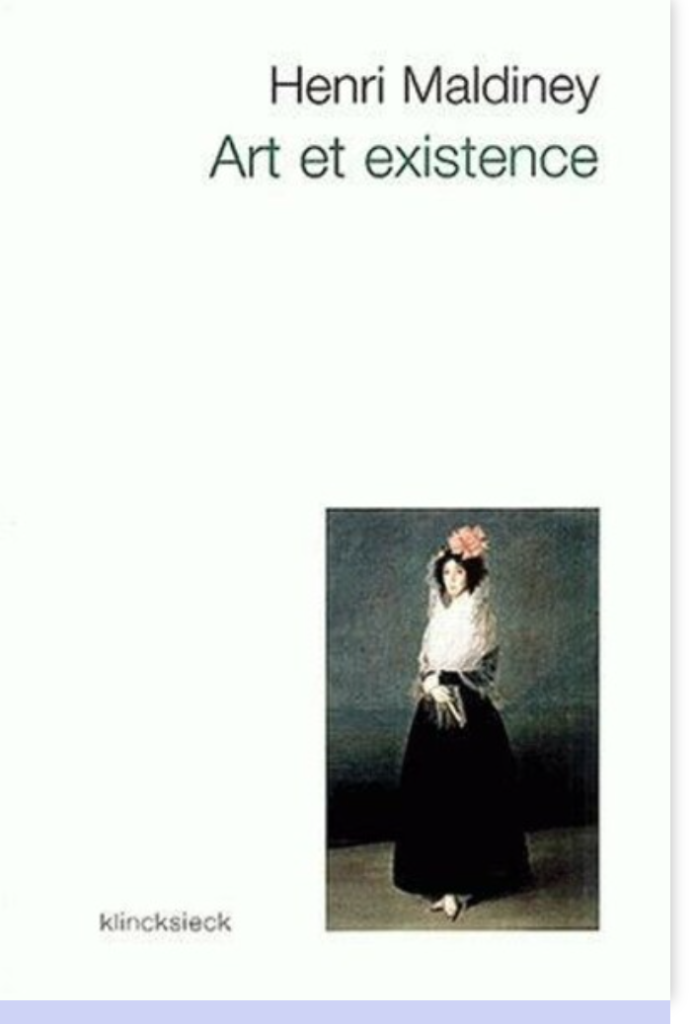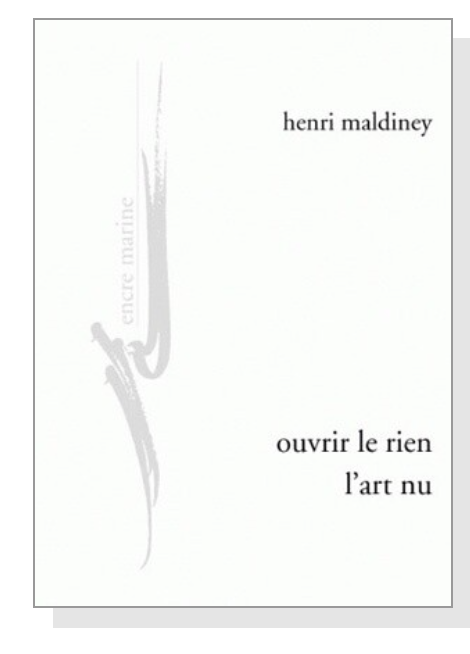Pour télécharger le pdf : cliquez ici
LE PAROXYSMAL DANS L’ART Henri MALDINEY
Il y a des arts dont le propos fondamental est de viser au paroxysme de l’expression. On les appelle “expressionnistes”. Dans ses “Notes sur la peinture d’aujourd’hui”, Jean Bazaine en a défini rigoureusement l’esprit. « Torturer une forme pour la sentir vivre, c’est à ce jeu relativement facile que se prête l’expressionniste, et c’est ce que l’honnête homme appelle, avec un frisson qui pour une fois ne l’abuse pas : déformer. Qu’il vise à être tragique ou naïf, l’expressionnisme est donc le résidu d’un certain décalage entre une Nature acceptée comme telle les yeux fermés, et l’interprétation qu’il en donne… Si l’expressionniste déforme un visage, c’est pour nier un visage “réel” admis a priori, et il ne s’affirme que dans la mesure où il s’en écarte : cette Sacrée Réalité, il se garde bien d’y toucher puisqu’il n’existe qu’en proportion de son refus et du souvenir que nous conservons d’elle : elle sort de ses mains inchangée. »[1] C’est donc « la règle du jeu que ce désir de domination plutôt que de possession, jamais assouvi, fasse appel à des moyens d’attaque de plus en plus violents, et que ces moyens s’usent à mesure et per- dent rapidement de leur pouvoir. (…) L’expressionniste n’est pas un révolutionnaire, ce n’est qu’un révolté qui prétend se venger d’un monde qu’il croit définitivement fermé. »[2]
“Torturer une forme pour la sentir vivre” est un acte de sadisme. Bazaïne, toutefois, dit autre chose encore qui déplace l’accent et le sens de l’opération : l’expressionnisme tente de satisfaire un besoin non de possession mais de domination. Et il le fait par violence et désir de vengeance. Il relève donc d’une autre dimension que celle du couple Éros-Thanatos qui définit la sphère du sexuel. L’expressionniste, ajoute-t-il, est un révolté : il se révolte contre la loi, même non écrite, de cette “Sacrée Réalité ” à laquelle il se garde de toucher et devant laquelle, interdit, il trépigne en accumulant de la haine. Sa révolte, qui ne transgresse pas la loi dont elle a besoin à titre d’obstacle, ne s’entretient qu’en tendant au paroxysme. Cette autre dimension est donc celle du paroxysme.
“Paroxysme” est un mot qui donne lieu à deux adjectifs : “paroxystique” et “paroxysmal”. Les deux ne coïncident pas. En effet, le mot “paroxystique” peut être appliqué à n’importe lequel des vecteurs szondiens pourvu qu’il y ait une forte accentuation de l’un ou des deux termes, notamment s’ils sont disposés diagonalement. Tandis que “paroxysmal” désigne un vecteur pulsionnel bien défini, propre à un domaine spécifique : le domaine des affects. Or, la notion d’affect est aussi ambiguë que celle de paroxysmalité. Pour le donner à entendre, je dirai d’un mot (que je tenterai de justifier par la suite)que le paroxysmal est ce que les Grecs appelaient le “démonique”.
A ce sujet, citons le livre d’Alfred Weber, “Le tragique et l’histoire”. « L’intuition grecque du démonique est multiforme et a changé au cours du temps. Mais, s’il est juste de dire que cette intuition a son fondement originel dans la représentation chtonienne magique [remarquez les deux termes : khthôn, la terre; magique, le pouvoir sur la terre] de l’imprégnation du tout par des puissances partout vivantes, et si les dieux grecs, même là où ils ont une origine historique particulière, soit dans la sphère olympienne, soit dans la sphère chtonienne, avaient tendance à introjecter en eux, dans leur figuration mythico-religieuse, des complexes de puissance chtonienne et ainsi, vus de l’arrière-fond de l’existence, à cristalliser dans une certaine mesure ces complexes de puissance en des contours propres à une personnalité, alors la charge de force démonique que comporte tout le divin grec, nous la comprenons dans son ambivalence. Il est compréhensible que le démonique doit être ici un genre de la ‘constitution de l’existence, c’est-à-dire un arrière-fond de puissance, mais aperçu seulement de façon informe ou à demi-formé, d’où occasionnellement se forment, à chaque fois, des puissances individuelles capables de faire irruption dans la vie, pour s’enfoncer à nouveau dans ce fond une fois l’action accomplie. » Je pense que l’on reconnaît là un grand moment szondien du destin des pulsions. Au reste, quand ils parlaient de leurs démons, les Grecs désignaient ce que certains ont appelé un “dieu temporaire”. Nous voyons donc déjà l’importance du moment paroxysmal et du moment critique. Seulement, cela ne suffit pas car ce n’est pas simplement leur durée, mais aussi leur forme de personnalité qui distinguent ces puissances démoniques et qui donnent un visage particulier à chacune de leurs figurations.
D’abord ce sont des puissances adverses. En s’incarnant dans des êtres individuels, ces puissances adverses se livrent des combats, à leur tour individuels, tels qu’ils vont, au cours de l’évolution de la notion grecque de démonique, resurgir et avoir leur issue, au Vè siècle, dans la tragédie. Car il est remarquable que ce démonique soit beaucoup moins présent à l’époque homérique dont E. Staiger dit que la lumière du soleil représente les lumières (au sens de l’Aufklärung)de la pensée homérique. Même Hésiode, qui est encore sous le signe d’Homère, accorde une place, dans son âge d’or, à des démons qui circulent dans les nuées au-dessus de la terre, mais qui sont des appuis pour l’homme. Au contraire, au Vème siècle, se présente ce tragique où s’affrontent ces puissances élémentaires, chtoniennes, magiques, adverses. Or, ici, cette sphère du démonique est d’autant plus effrayante qu’elle reste dans l’indéterminé. Et c’est parce qu’elle surgit de l’indéterminé qu’elle donne lieu, dans l’histoire de la Grèce, à l’invention de la tragédie. Car il n’en est pas du tout de même d’œuvres contemporaines, par exemple indiennes. Or, si nous examinons de près le ressort de ces tragédies (que ce soit Eschyle : “Les sept contre Thèbes”, que ce soit Sophocle : “Œdipe”, c’est-à-dire, en somme, les tragédies du cercle thébain)nous voyons que les puissances adverses se sont individualisées dans des êtres qui sont des êtres paroxysmaux. Songez à l’appel de six des sept contre Thèbes : la description même de leur allure et de leurs armes est une description où le démonique est véritablement proche, ici, du démoniaque. Mais surtout, c’est au cercle thébain qu’appartient le dieu qui représente, dans toute son ampleur, le démonique et l’affect : Dionysos.
Dionysos est le dieu bienfaiteur et le dieu destructeur, il est successivement, et presque simultanément, l’homme du e+ et l’homme du e-, pour parler en termes szondiens. A savoir : une accumulation de violence qui fait que, par exemple, certains de ses tenants se livrent à des actes de sauvagerie en déchirant les membres des animaux vivants; par ailleurs, certaines, au contraire, des compagnes, à la façon d’Ariane, sont dans un état extatique (dont les témoignages de l’art nous présentent presque l’extrême de la sérénité ). Or, cette double dimension que nous voyons dans Dionysos est celle que Théo découvre dans son frère Vincent. Dieu sait si l’amitié des deux a été fraternelle, profonde, et si Théo a été le perpétuel protecteur de Vincent, duquel il était le cadet de quatre ans. A l’époque de Paris, Théo écrit à sa sœur : « la maison est pour moi presque intenable. Il y deux êtres en lui : l’un, merveilleusement fin et doux, l’autre, égoïste et dur. Quel dommage qu’il soit son propre ennemi car il rend la vie difficile non seulement aux autres mais également à lui-même. »
Ce démonique appartient donc à la sphère paroxysmale, celle dont relève, presque en exclusivité, la tragédie grecque : il ne s’y agit jamais, finalement, de conflits de sentiments liés à l’amour, mais il s’agit presque toujours d’hubris, hyper-, au-dessus, marquant le super dont nous entretenait Ortigues. Il n’est pas jusqu’à Platon qui, dans “La République”, au moment où on évoque l’Un, fait dire plaisamment à Glaukon : “daimonia hyperbolès”, c’est-à-dire, “démonique transcendance”. Merveilleux dont il souligne le caractère ironique car le mot “daimôn” a, à la fois, le sens de démonique et celui d’une merveille divine. Cette dimension appartient à la tragédie. Elle appartient même à l’épos le plus tragique, lequel à mon sens est représenté par les sagas islandaises. Il ne s’y agit jamais de questions d’amour : le sexuel n’y joue, pour ainsi dire, aucun rôle. Au contraire, la violence est proprement la violence purement épique d’être porté à l’extrême de soi-même. D’où la nécessité de nous arrêter un peu sur la notion d’affect.
Cette notion n’est pas si claire. Comme R. Kuhn l’a rappelé, elle a été formulée d’abord par E. Bleuler dans son livre sur “La démence précoce et le groupe des schizophrénies”[3]. En fait, l’affect renvoie à émotion, passion, sentiment… en tant que le sujet en est, en lui-même, lui-même affecté. Et il l’éprouve en se ressentant lui-même — ce qui ne veut pas dire qu’il en soit conscient. Dès le contact, c’est-à-dire au niveau de ce que nous appelons la sensation, où un événement se produit et se produit à notre propre jour, le sentir est articulé intérieurement à un se mouvoir. Or, il en est de même de l’affect.
Choisissons l’exemple de l’émotion. Il n’y a pas d’émotion sans motion, mouvement. C’est là la dimension même des mouvements expressifs tels que les a définis E.J.J. Buytendijk et tels que G. Thinès y a insisté dans un article intitulé “La persistance du réalisme en psychologie”. Buytendijk écrit : « Une action ne modifie pas sa signification par une autre manière qu’on a de l’effectuer, parce que cette signification est extrinsèque à l’événement lui- même. Par contre, le mouvement expressif change de sens à chaque modification, même infime, des tensions ou mouvements musculaires. Je tiens le mouvement expressif pour l’activité la plus primitive sous sa forme primaire, mais elle est attitude, de plus, c’est-à-dire prise de position. Elle précède donc toute action. Ce qu’elle représente, c’est la mise en branle suscitée par le contact avec la situation, non seulement comme ébranlement, comme affect, conçu comme l’émotion d’un sujet, passif en l’occurrence, mais comme la motion faisant suite à cette émotion, comme la réponse en vertu de laquelle l’acte, qui doit être accompli et qui doit éventuellement développer la situation, se trouve anticipé. L’affect comporte une dimension centrifuge et l’in- tensité ou l’acuité de la réponse dépend de la capacité anticipative d’ouverture ou de fermeture de celui qui se trouve et s’éprouve affecté. » Entre une situation émotionnelle et la motion anticipative qui ouvre l’espace d’une réponse, il y a discontinuité comme aussi il y a discontinuité entre la motion et la réponse subséquente. Il s’agit donc de deux états critiques qui comportent une surprise. Si la réponse ne suit pas parce que la motion se perd dans un mouvement vertigineux, il y crise, celle-ci pouvant aller jusqu’à la perte du moi. En d’autres termes, le circuit des pulsions se trouve court-circuité entre le vecteur paroxysmal et le vecteur moi. D’où la réponse Sch 00. Le moment décisif de tout affect est celui de l’appropriation par le sujet d’une situation qui, en elle-même, a sa loi. Le type d’appropriation dépend du rapport de ce sujet à la loi comme l’ont dit Philippe Lekeuche et Jean Mélon dans leur “Dialectique des pulsions” : ou bien le sujet est exproprié de la loi et il a à s’approprier à elle, ce qui est une exigence éthique; ou bien il est le maître de la loi et il a à approprier la situation à soi, ces deux dispositions par rapport à la loi correspondent, d’un côté, au facteur épileptique et de l’autre au facteur hystérique[4].
Or, on peut dire que le démonique antique a été essentiellement lié au facteur épileptique et j’en veux pour témoin ce texte de Platon dans le “Phèdre” qui doit intéresser, en premier lieu, aussi bien les psychanalystes que les chamans. Il y est question de « .. ces maladies, ces épreuves, entre toutes graves, qui, par suite de ressentiments anciens, affectent, venant d’on ne sait où, certaines lignées. Le délire se produit et prophétise chez ceux qui étaient destinés à trouver le moyen d’écarter ces épreuves et ces maladies en recourant à des prières et à des services en l’honneur des dieux. Grâce à quoi, ayant rencontré des rites purificatoires et initiatiques, ce délire a mis à l’abri celui qui y a part | c’est-à-dire l’homme délirant, l’homme qui bénéficie de ce délire | pour le temps présent et pour le temps futur, en trouvant pour l’homme en qui délire et possession sont ce qu’il faut, c’est-à-dire envoyés par les dieux, la délivrance des maux présents. » Or, à quoi Platon fait-il allusion ici avec ce délire qui protège le délirant contre les maux qui peuvent accabler certaines lignées, c’est-à-dire toute la lignée familiale ancestrale szondienne ? C’est essentiellement une allusion aux corybantes de l’île de Samothrace qui, par leur danse au cours de la cérémonie d’initiation mettant en résonance les initiés avec leur danse même, les délivraient de ces états qui tournent à la chorée ou à la danse de Saint-Guy, voire à d’autres manifestations épileptiques. Quels sont les autres traits qui, en quelque sorte, signent ici l’épilepsie — cela aussi, naturellement, selon Szondi ? Il y d’abord le caractère religieux (l’épilepsie a été appelée “morbus sacer” : la maladie sacrée). D’autre part, on retrouve les traits dégagés par Szondi qui marquent le sens de la maladie caractérisée par ses trois phases spécifiques : la phase paroxysmale d’accumulation d’affects violents; la phase qu’il appelle “épileptiforme”, celle de l’attaque avec absence du moi; la phase dite “réparatrice” avec la possibilité du retournement. Tous ces traits sont présents dans certains héros de la littérature, qu’il s’agisse de l’auteur ou de ses personnages : je pense ici, bien sûr, à Dostoïevski et aux “Frères Karamazov”. Mais je voudrais l’esquisser rapidement à propos de l’Œdipe de Sophocle.
Dans ses “Remarques sur Œdipe”, Hölderlin observe ceci : dès le début, devant la foule des suppliants thébains qui viennent le trouver parce que la peste règne dans la ville et qui lui demandent de les sauver, Œdipe parle non pas en tyran (“turanno” c’est-à-dire en roi choisi, non héréditaire) mais en prêtre : il parle, en effet de miasmes, de souillure qu’il faut jeter hors de la ville, cela avant même d’avoir revu la délégation qu’il a envoyée consulter l’oracle de Delphes. D’emblée il donne donc tant un sens religieux qu’une solution religieuse à la situation et il lance contre ce miasme, cette souillure et le coupable de cette souillure une imprécation… laquelle va évidemment se retourner contre lui-même. Hölderlin dit : « une union illimitée entre l’homme et le dieu ne peut être purifiée que par une séparation illimitée à un moment où le temps se retourne. » Il y a le retournement du temps et celui-ci met l’accent sur ce retournement qu’a si bien marqué Szondi, ce qui est un moment particulier, éminent, de la phase réparatrice que l’on peut trouver également dans Œdipe. On peut le considérer, bien sûr, comme un errant puisqu’on le voit quitter Corinthe pour aller à Delphes, revenir de Delphes, arriver à Thèbes. mais surtout, une fois le drame joué, il reprend la route sur ses trois pattes, ses jambes et son bâton, pour parler le langage de la Sphinx. Bien davantage encore, il est un errant à l’intérieur de lui-même. « Le roi Œdipe a peut-être un œil de trop » a dit Hölderlin, qui tourne autour de qui il est et qui fuit, en même temps, qui il est. Cette errance est tout le sens de la tragédie. D’autre part, les accumulations d’affects sont innombrables chez Œdipe : la colère qui s’empare de lui dans sa rencontre avec Tirésias, sa colère violente contre Créon, sa colère contre le berger et n’oublions pas sa première colère contre Laïos qu’il ne sait pas être son père, mais ce sont deux hommes coléreux qui se rencontrent au carrefour de la route venant de Thèbes dont une branche va à Delphes. Cette lutte de Laïos qui veut l’écarter de son fouet et d’Œdipe qui le tue (mis à part ce symbolisme œdipien et il faut le mettre à part comme le fit également, à juste titre, Vergote dans son exposé?[5])c’est d’abord cette lutte du père et du fils qui rappelle cette réflexion à propos de Van Gogh qu’a faite un homme dont on a recueilli le souvenir voici quelques années. Cet homme avait été envoyé par le père de Vincent pour attendre celui-ci à la gare. Vincent débarquant, l’homme veut charger la malle du voyageur sur son dos. Van Gogh s’y oppose en disant : « chacun doit porter son propre fardeau ». Et l’homme d’ajouter : « tous les mêmes ces Van Gogh : des violents ! ». Tous les mêmes ces Labdacides, Laïos, Œdipe : des violents ! Inutile d’insister sur le moment paroxysmal final, celui qui coïncide à peu près avec, ou qui précède de très peu, la vue de Jocaste qui s’est pendue. L’automutilation : il se crève les yeux pour ne plus voir, parce que ne plus voir c’est aussi ne plus être vu, au moins par lui. À ce moment s’opère cette transformation : il est véritablement plein d’amitié, non pas suppliante, mais dirais-je à un niveau d’égalité avec Créon. Il y a ici une conversion véritable d’Œdipe. Tout ceci correspond bien, de point en point, à la description que donne Szondi de la paroxysmalité.
Je viens de parler de conversion. Mais réfléchissez à une autre : Saint Paul sur le chemin de Damas. Quelle accumulation d’affects ! Il part fulminant, ivre de violence contre les chrétiens de Damas qu’il est chargé d’aller persécuter, châtier. La crise survient dont il dit : « je ne sais pas si c’était dans mon corps ou hors de mon corps ». Ensuite, le retournement, la conversion qui ne consiste pas simplement à prendre parti pour ceux qu’il persécutait, mais à transgresser la loi, lui qui a dit : « la loi est cause du péché », pour la remplacer par l’amour ! Voilà exactement un retournement encore plus significatif que celui de Moïse…
Venons-en maintenant au démonique dans le paroxysmal de Van Gogh. Dans une lettre à Théo, Vincent écrit : « Je sens en moi une force que je dois développer, un feu que je ne puis éteindre mais que je dois attiser, bien que je ne sache pas vers quelle issue elle me mènera et je ne serais pas étonné qu’elle fût sombre. » Sur la question de la maladie de Van Gogh, la grande opposition de l’épilepsie et de la schizophrénie a été maintes fois agitée. Le principal tenant, et le plus respectueux d’ailleurs de Van Gogh, a été K. Jaspers[6]. Françoise Minkowska[7], avec également une très grande déférence pour Jaspers, se sépare radicalement de lui pour montrer en quoi Van Gogh était en tout cas de constitution épileptoïde. Comme J. Schotte a ajouté, à la façon de Szondi, il peut y avoir scène tournante et le clivage n’est justement pas quelconque.
Voici une lettre à Théo, du mois d’août 1889, où Vincent parle de ses délires, délires à contenu religieux et effrayant : « Alors que je vois qu’ici les crises tendent à prendre une tournure religieuse absurde, j’oserais presque croire que cela nécessite mon retour vers le Nord. Je suis étonné qu’avec les idées modernes que j’ai, moi un ardent admirateur de Zola et des Goncourt et des choses artistiques que je sens tellement, j’ai des crises comme en aurait un superstitieux et qu’il me vient des idées religieuses embrouillées et atroces telles que jamais je n’en ai eues dans ma tête dans le Nord. » Cette attitude critique, dans les états lucides, à l’égard des phénomènes délirants au cours des crises aiguës est exceptionnelle chez le schizophrène, dit Minkowska. Elle ajoute : « quant à moi, ce n’est pas seulement cette attitude qui ne me paraissait pas cadrer avec le tableau clinique de la schizophrénie, mais la façon dont les idées religieuses venaient envahir, avec une impétuosité irrésistible, la personnalité tout entière, en dépit de la résistance consciente que celle-ci essayait de lui opposer. » Le caractère religieux n’a jamais fait défaut à Van Gogh mais c’est un caractère religieux tout à fait particulier qui est à la fois religieux et cosmique. C’est une manifestation d’amour envers le prochain et envers le proche : appelant, par le “proche”, le monde dans l’immédiateté de la nature, et de la nature désarmée. En tout cas, Minkowska ne le considère pas comme une manifestation secondaire mais considère qu’il s’agit bien du sens d’un délire qu’on peut appeler primaire. Elle se range au premier jugement qui a été porté sur la situation de Van Gogh par le Docteur Peyron qui dirigeait l’hospice de Saint-Rémy. Dans une lettre de mars 1889, ce praticien écrit : « Je soussigné, docteur en médecine, directeur de la maison de santé de Saint-Rémy, certifie que le nommé Van Gogh Vincent, âgé de 36 ans, natif de Hollande, et actuellement domicilié à Arles, en traitement à l’hôpital de cette ville, a été atteint de manie aiguë avec hallucinations de la vue et de l’ouïe qui l’ont porté à se mutiler en se coupant l’oreille. Aujourd’hui, il paraît revenu à la raison mais il ne se sent pas la force et le courage de vivre en liberté et a demandé lui- même son admission dans la maison. J’estime, en conséquence de son état présent, que Van Gogh est sujet à des attaques d’épilepsie fort éloignées les unes des autres et qu’il y a lieu de le soumettre à une observation prolongée dans l’établissement. »
Si Minkowska acquiesce à ce diagnostic, c’est que sa conception de l’épilepsie se ‘rattache à celle des psychiatres français du 19è siècle. Il faut bien la comprendre. Dans le livre de W. Griesinger sur les maladies mentales, il y a un petit chapitre sur l’épilepsie. Griesinger dit que, pour les uns, l’épilepsie est une conséquence de la folie, pour les autres, c’est au contraire la folie qui est une conséquence de l’épilepsie. On voit ici s’opposer, en somme, des états psychiques que l’on pourrait dire répétés sinon chroniques, et ce qu’on appelle, proprement, la crise épileptique. Minkowska considère que la psychiatrie, depuis, a eu grand tort de se détourner de cette conception de l’épilepsie qui attache, au fond, plus d’importance encore aux situations et comportements psychiques qu’aux accidents convulsifs. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient séparables puisque cette accumulation d’affects, à un certain moment, se trouve incorporée. Nous voyons donc ici une convergence entre les affirmations d’A. Weber sur le démonique (sur ce surgissement occasionnel, sur le kairos, c’est-à-dire le moment où se manifeste au dehors le démonique sous la forme soit d’une divinité à figure particulière, soit d’un homme au destin tragique ), la conception de Minkowska et celle de Szondi. Car en somme, cette accumulation d’affects (dont je rappelais le rôle qu’elle jouait dans la dialectique des pulsions selon Lekeuche et Mélon)correspond à une phase d’adhésivité, tandis que la décharge des affects avec absence de moi, à une phase d’’explosivité. Ce sont là les deux pôles sur lesquels Minkowska entend la structure de l’épilepsie : adhésivité (elle dit : glischroïdie, viscosité)et explosion, éclatement.
La question n’est pas de savoir si Van Gogh est un épileptique qui a fait de la peinture. Il s’agit de savoir en quoi et comment la constitution paroxysmale de Van Gogh a affecté sa peinture. Je dirais que pour les uns, elle était destructrice, pour d’autres elle était, en quelque sorte, créatrice. En réalité, elle a dû être dépassée. Oui, dépassée. Et comment ? Tout d’abord au niveau paroxysmal, au niveau de l’affect. Rappelons-nous cette phrase de Buytendijk sur l’émotion qui est motion et anticipative. J’ai dit qu’elle pouvait être ouverture ou fermeture. Or, là où elle est ouverture, l’anticipation de l’affect ouvre à quoi ? D’abord, dirais-je, à la présence éminente qui est celle du moi. Comment y ouvre-t-elle ? De quelle façon ? Quel moi ? Si nous examinons l’œuvre de Van Gogh de ce point de vue, il y a, toutefois, deux choses assez élémentaires, mais assez méconnues, qui sont à rappeler.
D’une part, dans la peinture, la sculpture ou l’architecture, le vecteur paroxysmal et le vecteur sexuel n’ont pas, tant s’en faut, une importance égale à celle du vecteur contact et du vecteur moi[8]. Ce que dit Bazaine de l’expressionnisme doit s’entendre en ce sens que lorsque l’un ou l’autre, le vecteur S ou le vecteur P, prend le pas et s’impose directement, nous avons affaire à des œuvres, au sens propre, tendancieuses dans lesquelles le soi de l’artiste est constitué avant l’œuvre. Il est dans la situation qu’Hölderlin a appelée celle où un homme est dans “son ton propre”. Or, faire œuvre, ce n’est pas rester dans son ton propre, c’est s’établir dans ce qu’il appelle “le ton de son âme” qui est le ton contraire. Le passage de l’un à l’autre constitue la “métaphora”, le véritable sens de la métaphore : transport dans le contraire et contre-transfert du caractère artistique de l’œuvre sur la tonalité de l’homme. Ce qui veut dire que l’homme est façonné par son œuvre. Tandis que dans l’expressionnisme, l’homme est là. Que fait-il ? Il est en train de s’exprimer. Mais qui ? Il n’exprime pas quelqu’un qui n’existe pas, mais il exprime quelqu’un qui est là. Or, exister n’est pas être : exister, c’est toujours être hors, c’est être à l’avant de soi et non pas du tout se poser d’abord devant soi-même. comme un dessus de cheminée qu’on va ensuite traduire en miroir ou en gesticulant.
D’autre part, l’art n’est pas un produit des pulsions : il est de l’ordre de l’existence et l’existentiel n’est pas le pulsionnel. Cela Szondi l’a parfaitement perçu dans sa distinction du “destin contrainte” et du “destin choix”. Il est le seul qui, véritablement au risque d’une contradiction interne, fait la distinction et l’opposition, en l’homme, de nature et de liberté (celle que Kuhn a rappelée à propos du texte de Binswanger “Fonction vitale et histoire intérieure de la vie”[9]). On peut dire que l’artiste n’est jamais réductible à “l’homo natura” et que l’œuvre d’art n’est jamais non plus une surdétermination de la prose du monde. Je crois que la formule la plus vraie serait celle de Malévitch, qu’il s’agisse du monde intérieur ou du monde extérieur tout fait constituant le fameux anneau de l’horizon : « il faut que l’artiste brise l’anneau de l’horizon qui entraîne l’artiste loin du but de sa perte. » Eh oui, qui n’a pas commencé par perdre pied ne fera jamais œuvre. Ce moment de l’absence, du vide, du rien est le seul moment d’où puisse jaillir L’improbable, c’est-à-dire une véritable création. Il s’agit donc de retrouver dans l’œuvre de Van Gogh des témoignages mêmes de ces moments, c’est-à-dire la manière dont lui-même, non pas a vécu simplement, mais a existé ce dépassement pulsionnel.
En séminaire hier, nous avons examiné ce qu’était le moi, au sens szondien, de Van Gogh. Tous les témoignages montrent qu’il s’agit vraiment du moi que Szondi appelle celui du travailleur compulsif, forcé : Sch ++. Or ce profil est susceptible de deux interprétations : ou bien il s’agit d’un moi surtendu ++ qui se nie (k- ) : qui nie à la fois son vouloir être tout et son vouloir tout être/avoir; ou bien il s’agit de l’affirmation, sous forme d’incorporation (k+), du moi inhibé (- + ), incorporation qui se fait dans le raidissement qui prépare la crise. Il manque un radical, justement p-, lequel est le radical participatif, pas du tout celui de la persécution, mais le radical de la participation à l’altérité. Or, Van Gogh dit : « je me sens en présence de quelque chose de plus grand que moi qui est ma vie, la puissance de créer. » “De plus grand que moi ” : Van Gogh n’est jamais un inflatif. Il se trouve, en quelque sorte, confronté à une alternative : ou la crise, ou l’oeuvre. La crise paranoïde (p-) il l’a éprouvée à un moment très précis où il était en train de peindre, à Saint-Rémy, l’entrée d’une carrière et il a écrit, quelques temps après, comment, malgré cela, il avait tenté de continuer. Ce radical p- va réaliser, au moment où il fait œuvre, le mot intégral-intégré. C’est cette intégration du moi qui sauve, en quelque sorte, Van Gogh. Mais, le moi intégré est, dit Szondi, le moi qui pressent les catastrophes. Dieu sait si Van Gogh les pressent dans son œuvre même. Le moi opposé au moi intégré, c’est le moi absent (00). C’est bien ce qui, à plusieurs reprises, s’est produit chez Van Gogh. Pourtant, cette auto-intégration du moi de Van Gogh ne peut pas se faire autrement que dans l’agir d’un faire œuvre comme celui qui l’a conduit. Nous allons observer dans l’œuvre de Van Gogh les traits épileptoïdes : à la fois cette adhésivité et cette explosivité. L’adhésivité, nous la verrons jusque dans sa touche : dans ces touches grasses, épaisses, qui communiquent entre elles en circulant quelques fois très lentement, très visqueusement les unes dans les autres. L’explosivité, nous la verrons paraître en observant que ses œuvres se présentent souvent comme un assemblage dynamique de ce que nous appellerons, en termes du Rorschach, des grands détails. Je pense par exemple au Semeur : il y a le soleil, l’arbre, l’homme… et tout ça explose, chacun en soi-même. C’est parce qu’ils explosent en eux-mêmes qu’ils vont communiquer. Mais pourquoi ? Quand je dis qu’ils explosent chacun en soi-même, je dis par-là que chacun d’eux participe de cette base et de ce dépassement commun qu’est la surface de la toile. Chez Van Gogh elle reste toujours une surface spatialisante dont les tensions superficielles, quelles qu’elles soient, s’ordonnent en espace parce qu’elles sont toujours en rythme. Si nous voulons comprendre le rôle du rythme chez Van Gogh, il faut voir ce qu’il en advient déjà de la viscosité. Cette glischroïdie est manifeste, lors des phases les plus morbides de Van Gogh, dans l’épaisseur de ses couleurs qui tendent, en effet, à rester en elles-mêmes, telles qu’elles pourraient donner la tentation de les toucher, d’y poser la main. Mais elles sont prises dans un vertige, et ce vertige dissipe réellement cette viscosité, il la fait éclater. Seulement le rythme est la seule réponse au vertige. C’est dans la mesure où Van Gogh a été capable de trouver le rythme intégral de sa toile qu’il a transformé de l’intérieur son vertige en rythme et qu’il échappe ainsi à la fois à l’explosivité et à l’adhésivité de ses couleurs.
Quelle est la condition qui rend cela possible ? Au fond, quand il est arrivé à Paris, Van Gogh a découvert deux choses : l’impressionnisme et les estampes ou reproductions de la peinture japonaise. Il a dit une chose tout à fait remarquable sur les Japonais, ce qui serait encore plus vrai des Chinois : « C’est extraordinaire : ils ne remplissent pas ! » Ceci est fondamental. Un tableau n’est pas un garde-meuble où on loge des éléments. La notion de contenant et de contenu est ruineuse de la peinture parce qu’on “introduit des choses”, ce qui n’a aucun sens. Un tableau est sans distance. D’ailleurs François Cheng[10] fait remarquer que, dans les trois formes dites de perspective chinoise (en hauteur, en profondeur et dans l’éloignement ), en général il y a comme trois niveaux séparés par des vides et le vide, dit-il, n’est pas mesurable. C’est très important : il n’y a pas d’espace non seulement pictural ou musical, mais il n’y pas d’espace poétique (poïétique)qui soit mesurable. La métrique est le contraire même de l’art : elle loge les choses, elle les prend, les transforme… mais elle ne peut être créatrice d’un espace car le rythme répugne à la mesure qui ne peut lui être qu’un obstacle, peut-être dont il usera en le détruisant, mais jamais en s’y soumettant. Or, ce vide, on le trouve jusqu’à la fin dans les tableaux de Van Gogh. Il ne remplit pas son ciel intégralement de bleu. Même au moment où s’affirment le plus en lui la viscosité et l’explosivité, notamment dans ces formes très caractéristiques des dessins épileptiques que sont les boucles répétées se fermant plusieurs fois sur elles-mêmes, même à ce moment-là, par exemple ces arbres qui sont faits de cette façon ont une ouverture dans le vide, dans le rien. Dans un rien qui est actif : c’est lui qui active tout le reste. À quoi cela tient-il ? Tout d’abord à un rythme. Le rythme, on ne le perçoit pas au sens de la perception : il ne peut pas être objectif, il n’est jamais devant vous. Ou vous êtes dedans, ou vous n’y êtes pas : vous n’êtes pas au rythme. C’est, en somme, une forme d’existence et pas du tout un objet de représentation. Voilà pourquoi Sartre et Husserl se sont mépris sur l’art lorsqu’ils ont dit, par exemple, que la peinture était un espace imaginaire. L’espace rythmique n’est pas du tout un espace imaginaire. Quelle en est la condition ? Cette condition, je l’ai nommée quand j’ai parlé d’ouverture.
Ce qui caractérise, d’une façon générale, la psychose, c’est l’incapacité d’accueil à l’événement[11]. Il n’y a pas d’événement si ce n’est l’événement de la psychose elle-même, c’est-à-dire la métamorphose de la présence qui a lieu une fois et qui s’entretient indéfiniment, se répète, s’explicite, mais ferme à tout autre événement. Or, il y a chez Van Gogh, une puissance d’accueil à l’événement : que ce soit quand il était dans le Borinage, l’événement du coup de grisou ou du typhus qui a frappé les mineurs de l’endroit; que ce soit quand il était peintre, cet événement qui est la première forme de tout événement et qui se donne dans le sentir, à savoir le surgissement immotivé de quelque chose comme un monde que nous appelons le monde. Pourquoi y a-t-il du jaune, du brun, du liquide. et comment peuvent-ils se réunir ? Ceci n’a aucune signification. C’est véritablement ce qui est, justement, à rendre possible mais dont l’effectivité est dénuée de sens. C’est la gratuité totale. Van Gogh était toujours ouvert à cet événement du sentir qui est tel que ce qui vient à mon jour m’ouvre moi-même au jour. Au fond, tout éveil (et tout sentir est un éveil)est co-naissance : co-naissance de moi avec le monde. Bien entendu, dans le courant de la vie, nous ne sentons plus, nous ne faisons que percevoir. Nous prenons les choses, nous passons entre les bancs, mais nous ne rencontrons pas. Pour saisir l’être des choses, il faut se saisir soi-même explicitement et intégralement comme existant. Or, combien de fois nous saisissons-nous explicitement comme réellement existant ? La chose est rare…
[1] Ce texte est une retranscription de l’exposé oral prononcé par l’auteur, sans que cette version écrite n’ait été revue par ce dernier, notamment pour préciser les références de certaines citations. Quelques allusions renvoient au contexte du colloque durant lequel cet exposé fut proposé
[2] BAZAINE, J., Notes sur la peinture d’aujourd’hui, Paris, Seuil, 1953, pp 42-43. 21bidem, pp 43-44.
[3] 3 BLEULER, E., Dementia praecox ou Groupe des schizophrénies, Trad. par A. Viallard, Paris, E.P.E.L. et G-R.E.C., 1993
[4] LEKEUCHE, Ph. et MELON, J., Dialectique des pulsions, 3è éd. revue, Bruxelles, De Boeck, Bibliothèque de pathoanalyse, 1990, Cfr chap. 7 ” Le circuit des affects”.
[5] VERGOTE, A., La violence paranoïde de Caïn et son humanisation. (Dans ce même volume).
[6] JASPERS, K., Strindberg et Van Gogh, Trad. par H. Naef, Paris, Hd. de Minuit, 1953.
[7] MINKOWSKA, F., Le Rorschach. À la recherche du monde des formes, Paris, Desclée de Brouwer, 1956. Van Gogh, se vie, sa maladie et son œuvre, Paris, Presses du Temps Présent, 1963. De Van Gogh et Seurat aux dessins d’enfant. A la recherche du monde des formes (Rorschach ), Édité à l’occasion de l’exposition au Musée pédagogique du 20 avril au 4 mai 1949, Beresniak, 1949.
[8] MALDINEY, H., Esthétique et contact, in SCHOTTE, I. (éd.), Le contact, Bruxelles, De Boeck, Bibliothèque de pathoanalyse, 1990.
[9] Ce texte est repris dans BINSWANGER, L., Introduction à l’analyse existentielle, Trad. par J. Verdeaux et R. Kuhn, Paris, Ed. de Minuit, 1971.
[10] CHENG, F., Vide et plein. Le langage pictural chinois, Paris, Seuil, 1979.
[11] MALDINEY, H., Penser l’homme et la folie à la lumière de l’analyse existentielle et de l’analyse du destin, Grenoble, Millon, Coll. Krisis, 1991. 46